Numérique/Division : Les meilleures musiques électroniques de juillet, examinées
Digital/Divide est une colonne mensuelle consacrée à tous les genres et sous-genres du grand et beau monde de la musique électronique et de danse.

Avec un catalogue étendu plein d'œuvres pseudonymes, Kevin Martin continue de faire sensation après des décennies dans le milieu. Suite à des années de partenariat avec Justin Broadrick de Godflesh, son ascension en tant que The Bug l’a rendu redoutable tant au Royaume-Uni qu'à l’étranger. Peu peuvent manier la basse comme Martin, généralement sous forme de dancehall et de reggae. Ses sessions live repoussent régulièrement les limites des meilleurs systèmes de son, sans parler des tympans humains.
Une partie clé du travail de Martin en tant que The Bug repose sur la collaboration. Des premiers disques comme Pressure en 2003 le voient aux côtés de talents jamaïcains comme Daddy Freddy et Wayne Lonesome, tandis que des collaborations plus récentes incluent Dylan Carlson du groupe de drone metal Earth et le chouchou du post-dubstep Burial. Par défaut, ces projets l'ont toujours mis sur un pied d'égalité avec, ou même plus en avant que, les autres artistes. Peut-être que cela explique pourquoi ce nouvel album mettant en lumière la chanteuse israélienne Miss Red semble si important et différent.
Connue auparavant pour ses contributions à l'EP Security de Gaika et à l'album Angels & Devils de The Bug, sa voix imprévisible résonne à travers K.O. [Pressure]. Oscillant entre sinistrement contenu et parfaitement tumultueux, la prestation de Miss Red dévaste à chaque fois. Glaciale et menaçante, elle règne sur “One Shot Killa” et “War,” deux des moments forts de son disque. Et oui, avec tout le respect dû à The Bug, c’est bien son spectacle. De la brutalité initiale de “Shock Out” aux dynamiques dansables de “Come Again” et bien plus, les rythmes de Martin rappellent la force et la précision des pistons, un témoignage de son savoir-faire. Mais Miss Red mérite sa part de gloire ici, éblouissante sur le digital “Clouds” et le dystopique “Memorial Day.” Les fans de dancehall et les novices devraient attraper sa vague de mutilation.

Lotic, Power [Tri Angle]
Ce n'est pas surprenant étant donné leur association avec l'icône avant-gardiste Björk, cet artiste né à Houston et basé à Berlin apporte de la tradition à l'indicatif avec cet album attendu depuis longtemps. On pourrait pardonner à celui qui écoute les rythmes industriels de “Distribution Of Care” ou de la chanson titre de négliger l'amour de Lotic pour les fanfares texanes. Ils combinent et décombinent beaucoup de choses tout au long de Power, avec l'identité de genre et raciale au premier plan. Leur refrain murmuré sur “Hunted” donne des frissons alors que les machines diligentes et les riffs de synthé créent une atmosphère tendue. Ce qu'ils réalisent avec une formule plutôt simple de mélodie et de bruit défie les genres et dépasse les attentes, écrasant les pistes de danse en poussière de kétamine sur “Resilience” et le clin d'œil-induisant “Heart.” Pour un album thématiquement axé sur l'autonomisation, des moments tendres comme “Fragility” offrent un temps précieux et bien apprécié pour réfléchir sur les déclarations et les sonorités ailleurs sur l'album. La morceau de clôture “Solace” canalise la brillante excentricité de leur ami islandais avec une ballade grinçante pleine de sentiments d'espoir.

Ratgrave, s/t [Apron]
Bien que le nom choisi pour ce projet suggère quelque chose de déplaisant et d'inaudible, Ratgrave a plus en commun avec Thundercat qu'avec Cattle Decapitation. Leur sortie éponyme couronne un voyage de trois ans de jazz électronique pour Max Graef et Julius Conrad, artistes berlinois avec des sorties respectives sur des labels comme Ninja Tune et Tartelet Records. Peu importe à quel point cela devient amusant et espiègle, Ratgrave ne semble que rarement comme une comédie, un spectre qui semble toujours planer sur les disques contemporains évoquant l'immersion du funk et de la soul dans la fusion. “Fantastic Neckground” galope sur sa ligne de basse, tandis que “Blizzard People” rebondit joyeusement avec son orgue Hammond avant de se dissoudre dans une béatitude à la Boards Of Canada. En mettant de côté les noms farfelus, il y a quelque chose de sincère dans l'expérimentation de “Big Sausage Pizza” et “El Schnorro,” sans oublier l'ouverture tout-en-un “Icarus.” Même si Conrad et Graef s'amusent vraiment, leurs talents évidents font de cet album une belle addition au nouveau canon aux côtés de Drunk de Thundercat.
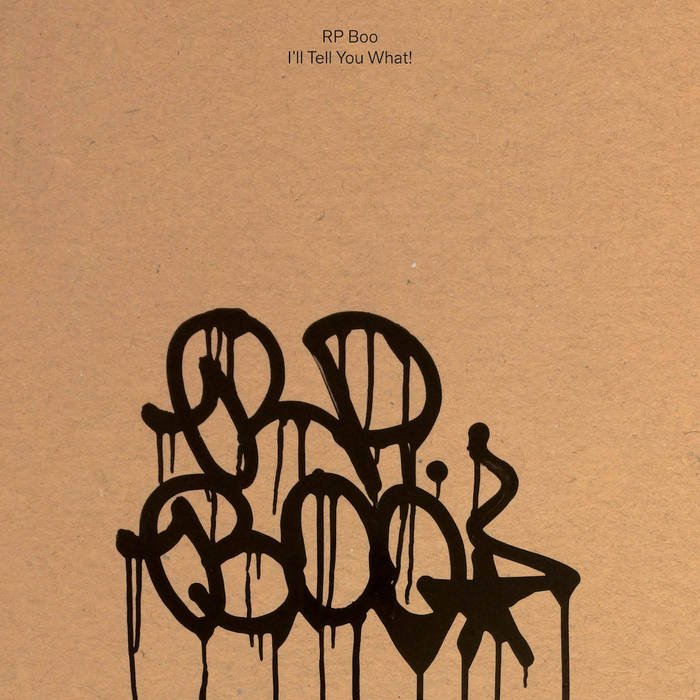
RP Boo, I’ll Tell You What! [Planet Mu]
Une chose curieuse à propos de la discographie de Kavain Space pour le label orienté footwork Planet Mu est sa nature principalement archivistique, avec des sorties en longueur comme Fingers, Bank Pads, & Shoe Prints de 2015 plus similaires à des compilations en esprit qu'à des albums. Donc l'arrivée de son dernier ensemble, le tonitruant I’ll Tell You What!, mérite l'attention pour son focus singulier sur le nouveau. En tant qu'un des pionniers du genre, on ne pourrait guère lui reprocher si ce matériel plus récent semblait en quelque sorte moindre par rapport au reste du catalogue de RP Boo. Heureusement, ces douze morceaux se maintiennent aussi bien face aux classiques underground du parrain que ceux des étoiles actuelles de la scène. La qualité désorientante de “At War” le maintient connecté aux tendances plus expérimentales du footwork, tandis que le mixage avec Stevie Wonder “U-Don’t No” démontre la beauté absolue possible dans la musique basée sur des échantillons. Qu'il distribue de la soul sur “Earth’s Battle Dance” ou teste la réponse des basses de vos enceintes sur “Bounty,” RP Boo captive constamment.

Xzavier Stone, THIRST [Fractal Fantasy]
Une des meilleures tendances de cette partie des années 2010 est l'érosion constante des frontières entre le R&B, le hip-hop et la musique expérimentale, en grande partie, mais pas exclusivement, via le monde urbain et amorphe de la basse. Dans ce champ de producteurs en constante expansion, on peut faire confiance à Sinjin Hawke et Zora Jones pour choisir un gagnant, et leur dernière sortie du signataire de leur label, Xzavier Stone, le prouve. Un ensemble pour les boîtes de nuit destiné à un certain état d'esprit, son album passe avec habileté et style de l’agressif (“Po It Up”) au futurisme funky (“Roll 2 Tha Door”). Une série de griffonnages, de claquements et de demandes haletantes, “Give Me Sum” ressemble à Oneohtrix Point Never essayant de faire de l’EDM trappy. Le balancement des cordes synthétisées sur “Chokehold” glisse en douceur dans “XLYT” dominée par le piano. Parfois traitée en des tons extraterrestres, la voix de Stone joue un rôle significatif ici, ajoutant à la fois un message et une texture à “CCW” et “Oud.”
Underworld & Iggy Pop, Teatime Dub Encounters [Caroline]
Les vieux grincheux pourraient froncer les sourcils face à cette sortie collaborative comme beaucoup l'ont fait avec le bien plus radical LuLu de Lou Reed et Metallica. Ceux qui s'abstiennent de réactions épidermiques face à leurs artistes préférés qui prennent des directions différentes tard dans leur carrière trouveront qu’Iggy Pop s'amuse beaucoup plus à danser avec les gars d'Underworld qu’il ne l’a fait en jouant avec Josh Homme. Le parrain du punk a déjà fait l’exercice de la poésie de performance, notamment sur son album solo de 1999 Avenue B. Lorsque le morceau techno motorik “Bells & Circles” présente à Iggy une hypothèse anodine, il répond par des réminiscences de connexions manquées, de démocratie libérale et de vieilles cigarettes. Il fait de son mieux pour imiter Alan Vega sur l’électro-punk “Trapped,” une chanson cyberpunk entraînée par la répétition. Karl Hyde et Rick Smith donnent à la voix grave de l’aîné beaucoup d’espace sur “I’ll See Big,” sa réflexion sur l’amitié et les différentes sortes de relations résonnant comme une sagesse alcoolisée. “Get Your Shirt” se rapproche le plus de l’esthétique Underworld, jubilant et épique de bout en bout.
Gary Suarez est né, a grandi et vit toujours à New York. Il écrit sur la musique et la culture pour diverses publications. Depuis 1999, son travail est apparu dans plusieurs médias, y compris Forbes, High Times, Rolling Stone, Vice et Vulture. En 2020, il a fondé la newsletter et le podcast indépendants de hip-hop Cabbages.








